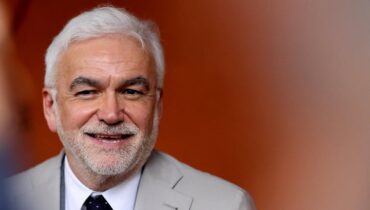📌 La proposition du syndicat qui divise : « Vacances d’automne » au lieu de « Toussaint », « fin d’année » à la place de « Noël »

Posted 3 octobre 2025 by: Admin
La Proposition Controversée Du Syndicat FSU-Snuipp
Le FSU-Snuipp, premier syndicat d’enseignants en maternelle et élémentaire, vient de déclencher une polémique nationale en proposant de rebaptiser les vacances scolaires traditionnelles. Fini les congés de « Toussaint » et de « Noël », place aux « vacances d’automne » et « de fin d’année ». Cette initiative, motivée par le respect de la laïcité, marque une rupture symbolique avec la nomenclature historique du calendrier scolaire français.
L’organisation syndicale a officiellement porté sa proposition devant le Conseil supérieur de l’Education, instance consultative du ministère de l’Education nationale, sous forme d’amendement. Cette démarche institutionnelle transforme ce qui pourrait sembler anecdotique en véritable enjeu de politique éducative. « Exit donc les noms de fêtes chrétiennes, place à d’autres noms pour les vacances d’hiver, d’automne », confirme le syndicat à RMC.
La stratégie du FSU-Snuipp s’appuie sur une lecture stricte du principe de laïcité scolaire. En supprimant toute référence religieuse explicite du calendrier officiel, le syndicat entend harmoniser la terminologie administrative avec les valeurs républicaines. Cette proposition, désormais soumise à l’examen des instances éducatives, cristallise un débat plus large sur la place du patrimoine chrétien dans l’école publique française.
Les Arguments Pro-Laïcité Des Défenseurs Du Projet
Ce débat sur le patrimoine chrétien trouve ses plus ardents défenseurs parmi les enseignants eux-mêmes. Océane, professeure d’espagnol en collège et militante syndicale, développe une argumentation juridique tranchée sur RMC : « La laïcité ne peut pas être à géométrie variable, on ne peut avoir une religion suprémaciste sur les autres en utilisant l’argument éternel des racines ». Pour cette enseignante, la France contemporaine doit assumer sa diversité culturelle plutôt que de privilégier un héritage exclusivement chrétien.
L’argumentaire historique renforce cette position. Bruno Poncet, syndicaliste cheminot, rappelle le cadre légal fondamental : « Depuis 1905 la France a acté la séparation de l’Église et de l’État ». Cette référence à la loi de séparation ancre la proposition dans plus d’un siècle de tradition républicaine, transformant le débat sémantique en question de cohérence institutionnelle.
Les défenseurs du projet questionnent également la pertinence culturelle des références actuelles. « Est-ce que les gens savent ce qu’est la Toussaint ? À Noël, les gens savent qu’ils vont avoir des cadeaux mais ne savent pas pourquoi », interroge Bruno Poncet. Cette analyse sociologique suggère que les noms traditionnels ont perdu leur sens religieux originel, vidant de substance l’attachement proclamé aux « racines chrétiennes ».
L’approche défendue privilégie une vision plurielle de l’identité française, où « les racines ont toujours été le mouvement et l’interculture », selon Océane. Cette conception suscite néanmoins de vives résistances.
La Levée De Boucliers Face À Cette Initiative
Ces résistances ne tardent pas à s’exprimer avec une virulence surprenante sur les plateaux de RMC. Ryan, cadre dans le transport et de confession musulmane, dénonce frontalement une « perte de temps » : « Les Français de confession musulmane sont fiers de vivre ici, de fêter Noël et s’en fichent du nom des vacances. J’ai l’impression qu’il n’y a qu’en France qu’on veut effacer son histoire et ses racines ». Cette position inattendue d’un représentant des minorités religieuses fragilise l’argumentaire pro-laïcité.
L’avocat Charles Consigny radicalise l’opposition en ironisant sur « des gens qui ont du temps à perdre dans ces syndicats ». Sa charge contre les « générations d’analphabètes et de laïcards » révèle l’ampleur du fossé idéologique. « Il faut enseigner aux enfants ce qu’est la religion chrétienne, Pâques et Noël », martèle-t-il, inversant totalement la logique séparatiste.
Fred Hermel franchit un seuil supplémentaire en qualifiant les partisans du projet de « fous dangereux ». « La France est chrétienne, n’en déplaise à ces incultes qui donnent des cours aux enfants ! », s’emporte-t-il. Cette escalade verbale transforme un débat sémantique en affrontement identitaire majeur.
Le consensus transpartisan contre cette initiative dessine une France attachée à ses références traditionnelles, indépendamment des convictions religieuses personnelles.
La Mobilisation Politique Et Citoyenne Contre Le Projet
Cette opposition ne se limite plus aux plateaux télévisés. L’UNI, syndicat étudiant classé très à droite, révèle que le FSU-Snuipp a effectivement porté sa proposition devant le Conseil supérieur de l’Education, instance consultative du ministère de l’Education nationale. Cette officialisation transforme ce qui semblait être une simple déclaration médiatique en démarche institutionnelle concrète.
L’adoption de l’amendement par cette instance consultative déclenche immédiatement une riposte organisée. L’UNI lance une pétition contre le changement de dénomination, mobilisant un réseau militant structuré. Cette contre-offensive illustre la capacité de mobilisation des opposants au projet, dépassant le simple cadre des réactions spontanées.
Le passage devant une instance officielle confère une légitimité procédurale à la proposition syndicale, mais cristallise simultanément les résistances. « Après l’adoption de l’amendement », précise l’UNI, confirmant que le processus administratif a franchi une étape décisive.
Cette escalade institutionnelle révèle les mécanismes de contestation politique face aux évolutions sociétales. La mobilisation étudiante contre une initiative enseignante dessine un paysage éducatif fragmenté, où les questions identitaires traversent désormais tous les échelons de l’institution scolaire.
Le débat sur les appellations de vacances devient ainsi le révélateur d’une France en quête de consensus sur ses fondements culturels et républicains.