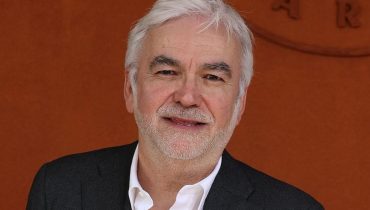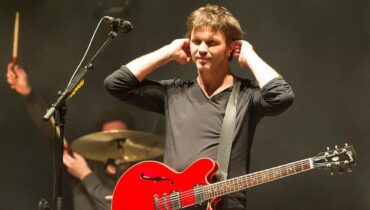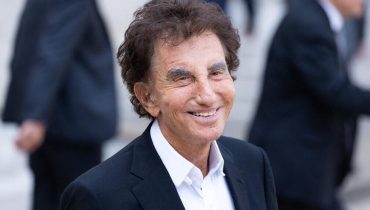📌 Vanessa Edberg tacle la proposition de Ciotti : « Cela va à l’encontre du droit fondamental… »

Posted 27 juin 2025 by: Admin
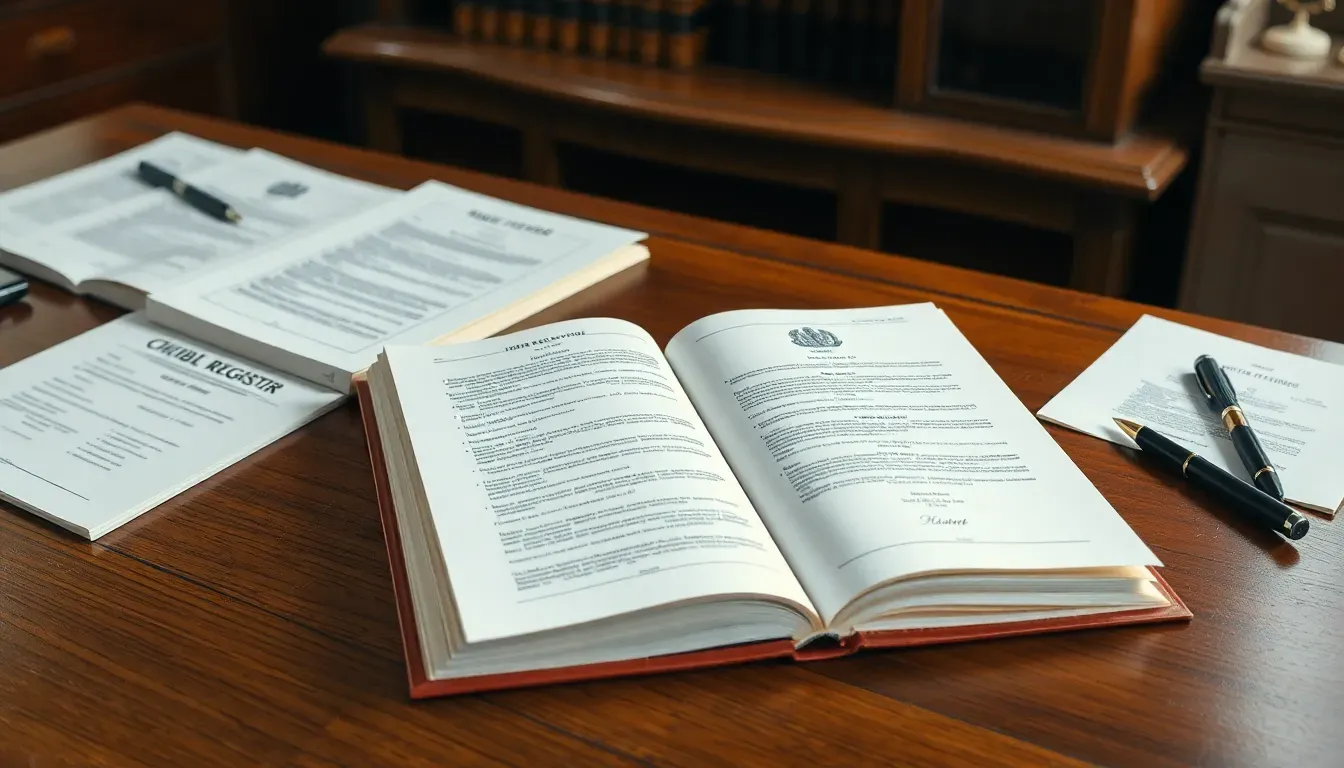
Ciotti À La Une: Une Proposition De Loi Controversée Sur Les Mariages Avec Des OQTF
Dans la continuité des débats qui secouent l’Assemblée nationale autour de la gestion des étrangers en situation irrégulière, l’initiative d’Éric Ciotti vient raviver les tensions. Le patron des députés UDR souhaite inscrire dans la loi une interdiction claire : empêcher les mariages avec des personnes sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Cette proposition, déjà adoptée au Sénat, s’inscrit dans un contexte brûlant, marqué par le cas emblématique de Robert Ménard. Le maire de Béziers, poursuivi pour avoir refusé de célébrer le mariage d’un étranger en situation irrégulière, risque aujourd’hui jusqu’à cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende. Un signal fort qui, pour certains élus, révèle l’ampleur du malaise.
Pour Éric Ciotti, il n’est plus question de détourner le regard. Il s’appuie sur le soutien affiché par Emmanuel Macron lors d’un échange télévisé avec Robert Ménard, et entend rallier le groupe centriste pour faire passer ce texte. Selon lui, la mesure vise à « réparer une profonde anomalie, celle qui oblige les maires à procéder à des mariages et les condamner s’ils refusent ». La colère gronde chez de nombreux élus locaux, qui se sentent pris au piège d’une législation jugée inadaptée face à la réalité du terrain. « C’est ahurissant, on marche sur la tête, les maires sont en colère et ont réclamé un texte qui émane du groupe centriste et que nous avons repris intégralement », martèle le député des Alpes-Maritimes.
L’enjeu est double : politique d’abord, dans un climat où la question migratoire reste un sujet sensible et polarisant ; juridique ensuite, avec la volonté affichée de donner plus de latitude aux maires confrontés à des situations complexes. Mais cette offensive législative soulève d’ores et déjà de vives réactions, tant sur le plan des principes que sur celui du droit. Si l’objectif affiché est de lutter contre les mariages blancs, la proposition de loi d’Éric Ciotti s’inscrit dans un débat beaucoup plus vaste sur les libertés fondamentales et le rôle de l’État dans la vie privée des citoyens.
À l’heure où les projecteurs se braquent sur l’Assemblée, la question de l’équilibre entre sécurité juridique et respect des droits individuels se pose avec une acuité renouvelée.

Le Droit National Et Européen Défie La Proposition De Ciotti
Dans ce climat de tension où la législation semble vaciller entre principe de précaution et préservation des droits fondamentaux, la proposition d’Éric Ciotti se heurte à des objections majeures venues du monde juridique. Vanessa Edberg, avocate spécialisée en droit des étrangers, ne mâche pas ses mots : pour elle, le texte porté par le député UDR va à l’encontre tant du droit national que des engagements internationaux de la France. « C’est contraire au droit national et à la convention européenne des droits de l’homme qui considère le mariage comme un droit fondamental », rappelle-t-elle fermement sur les ondes de RMC et RMC Story.
La Convention européenne des droits de l’homme, en effet, garantit à tout individu le droit de se marier, indépendamment de sa situation administrative. Restreindre ce droit reviendrait à porter atteinte à l’un des socles de l’ordre juridique européen. Pour les défenseurs des libertés publiques, ce projet de loi ouvre la voie à une dangereuse remise en cause de l’égalité devant la loi, en instaurant une discrimination fondée sur le statut migratoire.
La résistance ne s’organise pas seulement sur le terrain des principes. Soixante députés ont déjà annoncé leur intention de saisir le Conseil constitutionnel si la proposition venait à être adoptée. Ce recours, loin d’être anodin, rappelle la force de la séparation des pouvoirs et l’importance du contrôle de constitutionnalité dans notre démocratie. Vanessa Edberg insiste : « Un étranger pourrait soulever une question prioritaire de constitutionnalité et demander à ce que le juge écarte cette loi. » Ce mécanisme, au cœur de l’équilibre institutionnel français, garantit que toute nouvelle législation respecte les droits et libertés consacrés par la Constitution.
Le débat s’intensifie donc, bien au-delà du simple cadre politique. La confrontation entre la volonté de contrôle migratoire et le respect des droits humains met en lumière la complexité de l’équation à résoudre. À mesure que la controverse s’installe, la question de l’effectivité des dispositifs existants et des véritables enjeux pratiques s’impose dans le débat public.
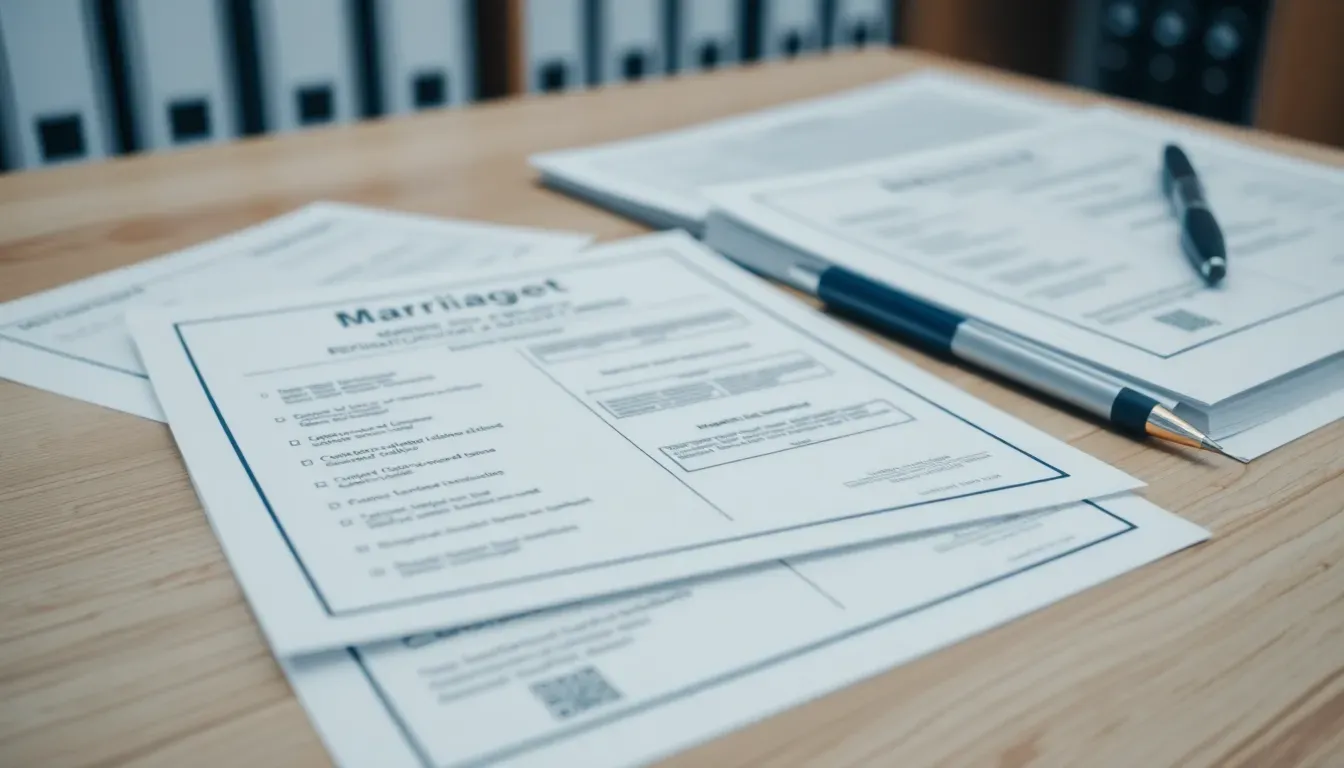
Les Mariages Avec Des OQTF: Une Réalité Complexe Et Rare
Alors que la tension monte autour des principes juridiques, il est essentiel de revenir sur la réalité concrète des mariages impliquant des personnes sous obligation de quitter le territoire français. Contrairement à certaines idées reçues, la procédure actuelle encadre déjà strictement ces situations. Un maire confronté à un doute sérieux sur la sincérité d’une union – notamment en cas de suspicion de mariage blanc – dispose d’un levier juridique : il peut saisir le procureur de la République. Dans ce cas, les futurs époux sont auditionnés par un magistrat, garantissant ainsi une investigation approfondie avant toute célébration.
Mais au-delà de la suspicion, la question de la régularisation se révèle particulièrement rigoureuse. Comme le rappelle l’avocate Vanessa Edberg, « le mariage ne donne pas un titre de séjour automatique ». Pour qu’un étranger sous OQTF puisse espérer une régularisation, le couple doit justifier d’une vie commune de 18 mois et l’intéressé d’une présence sur le territoire de 7 ans – un seuil abaissé à 5 ans avant la circulaire Retailleau. Ce double verrou juridique montre bien que le simple fait de se marier n’ouvre pas la porte à un séjour légal en France. La procédure reste longue et sélective, loin des raccourcis souvent évoqués dans le débat public.
De plus, les chiffres viennent relativiser l’ampleur du phénomène. D’après le député Aurélien Taché, les mariages concernés ne représentent qu’une fraction infime des unions en France : seulement 406 cas sur 250 000 célébrés en 2022. Autrement dit, moins de 0,2 % des mariages sont concernés par la présence d’une personne sous OQTF. Cette donnée interroge sur la nécessité de légiférer dans l’urgence, alors que le dispositif actuel paraît suffisant pour encadrer les dérives.
Si la question juridique reste brûlante, la réalité statistique nuance fortement l’impression d’une vague massive de mariages de complaisance. Entre procédures de contrôle déjà existantes et obstacles à la régularisation, la mécanique administrative française démontre sa robustesse. Pourtant, le débat ne faiblit pas, porté autant par des convictions politiques que par la perception de l’opinion publique face à l’immigration et à la souveraineté nationale.

L’Avenir Politique Et Juridique De La Proposition En Perspective
Dans ce contexte où la réalité des chiffres contraste avec l’ampleur du débat, la trajectoire politique de la proposition d’Eric Ciotti prend une dimension toute particulière. Le texte, déjà adopté par le Sénat, se retrouve suspendu à un équilibre fragile : celui du soutien, ou non, du groupe centriste à l’Assemblée nationale. Cette formation, souvent décisive lors des votes, détient en effet la clé de l’adoption potentielle du projet. Mais l’adhésion n’est pas acquise d’avance, tant le sujet divise jusque dans les rangs centristes, partagés entre la volonté d’agir contre les abus et le respect des principes fondamentaux du droit.
Par ailleurs, même en cas de vote favorable, le parcours législatif ne serait pas pour autant un long fleuve tranquille. Soixante députés ont d’ores et déjà annoncé leur intention de saisir le Conseil constitutionnel. Cette démarche ouvrirait la voie à un contrôle a posteriori de la loi, permettant à tout justiciable concerné de soulever une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Comme le souligne l’avocate Vanessa Edberg, « un étranger pourrait demander au juge d’écarter cette loi si elle venait à passer ». Ce risque de censure constitutionnelle plane sur l’ensemble du dispositif, alimentant une incertitude juridique majeure autour de son application réelle.
Dès lors, une question s’impose : faut-il mobiliser autant d’énergie législative pour un phénomène ne concernant qu’une poignée de cas chaque année ? L’argument de la symbolique politique prend ici le pas sur la réalité statistique, interrogeant sur la hiérarchisation des priorités au sein du débat public. Loin de se limiter à une simple bataille de chiffres, le dossier cristallise des enjeux de souveraineté, de sécurité et de respect des droits fondamentaux.
À l’heure où les regards se tournent vers les arbitrages parlementaires et les recours possibles, le débat s’enrichit de nouveaux angles, mêlant stratégie politique et interrogations sur l’efficacité de la norme. Ce jeu d’équilibres fragiles façonne désormais la suite du feuilleton législatif autour des mariages avec des personnes sous OQTF.