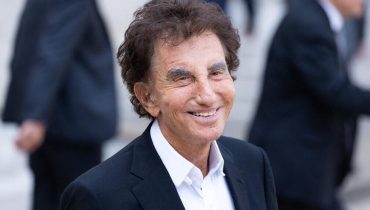📌 Pascal Praud accuse Delphine Ernotte : « Menteuse, voici pourquoi elle exclut ces invités… »

Posted 27 juin 2025 by: Admin

Delphine Ernotte Règle Ses Comptes Avec CNews Dans « Quotidien »
Dans la foulée d’une séquence déjà tendue, Delphine Ernotte choisit de sortir de sa réserve habituelle. Invitée sur le plateau de « Quotidien » face à Yann Barthès, la PDG de France Télévisions ne se contente pas de répondre : elle attaque frontalement. Sans détour, elle s’en prend à la chaîne CNews, adversaire déclaré du groupe public, et pointe du doigt une contradiction que beaucoup murmurent mais que peu osent dire à voix haute. « Ceux qui se revendiquent soi-disant de la liberté et qui nous expliquent ce qu’on doit faire, ce qu’on ne doit pas faire, ce qu’on doit dire… En fait, ce sont les vrais censeurs », lâche-t-elle d’un ton implacable.
Ce coup de griffe vise au cœur un débat brûlant : qui, dans le paysage audiovisuel français, détient le monopole du discours ? Delphine Ernotte revendique une ouverture totale : « Nous, à France Télévisions, on invite tout le monde. Il n’y a pas de débat là-dessus. On publie la liste de nos invités. On s’adresse à tout le monde. » La défense est ferme, presque solennelle, comme pour répondre à des critiques récurrentes sur le manque de pluralisme.
Accusée d’être « woke » par certains journalistes, la patronne de France Télévisions ne se dérobe pas. Avec une pointe d’ironie, elle retourne l’argument : « C’est l’arroseur arrosé. Je me demande s’il n’est pas un peu woke. » Cette réplique, cinglante, révèle à quel point le terme est devenu une arme dans l’arène médiatique. Derrière le mot, c’est tout un clivage qui s’exprime, entre ceux qui prônent l’inclusion et ceux qui dénoncent une forme de radicalité.
Pour Delphine Ernotte, la ligne est claire : la critique, oui, mais pas l’acharnement. « Ce que vous montrez ce n’est pas ça, ce ne sont pas des critiques, c’est une forme d’acharnement, de harcèlement du groupe public. » La tension monte d’un cran. En quelques minutes, le plateau de « Quotidien » s’est transformé en arène où s’affrontent visions du service public et accusations de partialité.
Dans ce contexte, chaque mot pèse lourd. Les déclarations de la PDG, loin de calmer le jeu, attisent les débats et suscitent des réactions immédiates dans le microcosme audiovisuel. La confrontation ne fait que commencer, et déjà les positions se durcissent, annonçant une riposte sans concession.

Pascal Praud Contre-Attaque Violemment
À peine les propos de Delphine Ernotte résonnent-ils sur le plateau de « Quotidien » que la riposte s’organise. Dès le lendemain, Pascal Praud, figure emblématique de CNews, prend la parole avec une virulence qui ne laisse aucune place à l’ambiguïté. Sa voix tranche, son ton se durcit : il égrène la liste de personnalités – Gilles-William Goldnadel, Arno Klarsfeld, Michel Onfray – qui, selon lui, n’ont jamais eu leur place sur les antennes de France Télévisions. Pour Praud, l’ouverture proclamée par la PDG n’est qu’une façade.
Il ne s’arrête pas là. Face caméra, il martèle : « Madame Ernotte est une menteuse ! Madame Ernotte est une menteuse ! Avec l’argent des Français. Quand elle dit qu’elle invite tout le monde, elle n’invite personne. Elle était grotesque. » Le mot claque, répété, soulignant l’intensité de son accusation. L’attaque ne vise pas seulement la politique éditoriale, mais la personne même de Delphine Ernotte, son image, son autorité. L’évocation de la poterie et du chant sur le plateau, anecdote glissée par Praud, cherche à tourner en dérision la dirigeante, à la présenter sous un jour décalé, presque absurde. « Elle était en train de chanter sur le plateau, on apprend qu’elle fait de la poterie. Non mais vraiment ! Et cette femme est PDG de France Télévisions. C’était vraiment grotesque ! »
Ce n’est plus seulement un débat d’idées, mais un affrontement frontal, presque personnel. Pascal Praud s’indigne, s’emporte, et par ses mots, c’est tout un pan du paysage audiovisuel qui s’enflamme. Il dénonce ce qu’il perçoit comme une confiscation du débat public, un entre-soi entretenu au sommet du service public. « Ces gens-là sont… C’est effrayant. » Le jugement est sans appel, la charge brutale.
En quelques minutes, l’échange devient symbole d’une fracture plus profonde. D’un côté, la volonté affichée d’inclusion ; de l’autre, la dénonciation d’un pluralisme de façade. Les arguments s’entrechoquent, les convictions se raidissent. La polémique enfle, alimentée par des mots forts et des images qui marquent, laissant derrière elle un climat électrique où chaque camp campe sur ses positions.

Le Fond Du Débat : Pluralisme Ou Autocensure ?
Dans cette atmosphère survoltée, une question persiste, en filigrane des invectives échangées : la promesse de pluralisme à France Télévisions est-elle vraiment tenue, ou assiste-t-on à une forme d’autocensure déguisée ? Le cœur du débat se déplace alors du terrain des déclarations fracassantes à celui, plus subtil, des lignes éditoriales et des choix de programmation. Pascal Praud, reprenant une critique déjà formulée en mai 2025, pointe du doigt le « politiquement correct » qui, selon lui, régnerait sans partage sur le service public.
« Le souci sur le service public, ce n’est pas tant ceux qui sont invités, ce sont les gens qui ne sont pas invités », affirme-t-il. Derrière cette phrase, se cache une interrogation plus large sur la place accordée aux voix discordantes, aux opinions minoritaires ou controversées. Faut-il y voir une volonté de préserver une certaine harmonie, ou, au contraire, le symptôme d’un entre-soi qui exclut ceux qui dérangent ? La conviction de Praud est claire : « Si vous ne correspondez pas à une certaine ligne… On sait bien qu’il y a un politiquement correct qui règne à France Télévisions, qui fait que sur certains sujets, des gens ne sont pas invités. »
Cette tension entre ouverture revendiquée et accusations d’exclusion nourrit le malaise. Les exemples cités – Goldnadel, Klarsfeld, Onfray – deviennent alors le point focal d’une critique plus globale, qui dépasse le simple cas d’une émission ou d’une invitée. Elle touche à la mission même du service public, à sa capacité à représenter la diversité des opinions dans l’espace médiatique français.
Mais où commence la ligne éditoriale, et où finit l’autocensure ? N’est-ce pas là le vrai nœud du débat, au-delà des personnalités et des attaques ad hominem ? Autant de questions qui traversent aujourd’hui le paysage audiovisuel, révélant des fractures idéologiques profondes et une défiance croissante envers les institutions médiatiques traditionnelles.

Une Guerre Des Médias Qui Divise L’Opinion Publique
Ce climat de défiance et de crispation, déjà palpable dans le débat sur le pluralisme, déborde désormais largement le simple cadre des plateaux télévisés. La confrontation entre Delphine Ernotte et Pascal Praud cristallise une véritable polarisation de l’opinion publique, où chaque camp campe sur ses certitudes. D’un côté, les défenseurs du service public voient en France Télévisions un rempart nécessaire face à la montée des discours partisans et à la fragmentation médiatique. De l’autre, les critiques libérales dénoncent un système verrouillé, soupçonné de favoritisme et d’exclusion sous couvert de « politiquement correct ».
Les mots de Pascal Praud, d’une rare virulence – « C’est effrayant » – résonnent bien au-delà du microcosme médiatique. Ils alimentent une défiance grandissante envers les institutions, mais aussi un sentiment d’injustice chez ceux qui s’estiment tenus à l’écart du débat public. Ce discours trouve un écho chez une partie de la population, lassée d’avoir le sentiment que certaines voix sont systématiquement marginalisées. À l’inverse, la défense passionnée de Delphine Ernotte, qui martèle l’ouverture et la transparence de France Télévisions, rassure ceux pour qui la mission du service public doit rester synonyme d’équilibre et d’inclusivité.
Ce clivage n’est pas anodin. Il met en jeu la crédibilité même des médias, leur capacité à incarner une parole commune dans un paysage fragmenté, parfois hostile. L’image de France Télévisions se retrouve ainsi prise en étau entre deux récits contradictoires : celui d’un bastion du débat démocratique, et celui d’une institution sclérosée, accusée de masquer ses failles sous des discours de façade.
Au fond, ce bras de fer médiatique agit comme un miroir grossissant des tensions qui traversent la société française. Quand chaque accusation, chaque mot fort – « menteuse », « grotesque », « effrayant » – devient une bannière brandie par l’un ou l’autre camp, la moindre polémique se transforme en symptôme d’un malaise profond. Et si la question n’était plus seulement de savoir qui a raison, mais de comprendre comment ce duel façonne, peu à peu, notre rapport collectif à l’information ?